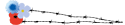La cavalerie pendant la Grande Guerre en Picardie
La Grande Guerre marque pour la cavalerie la fin d'une époque ancestrale faite de charges héroïques et glorieuses. Après des missions de reconnaissance et de patrouille au tout début de la guerre, c'est dans les tranchées que les cavaliers se sont retrouvés, partageant le quotidien des fantassins. En Picardie, plusieurs exploits, de 1914 à 1918, sont malgré tout à mettre à l'actif des cavaliers, qu'ils soient à cheval ou à pied.

Au moment de la déclaration de guerre, la cavalerie, chez tous les belligérants, occupe une place très importante dans l'organisation militaire, au même titre que l'infanterie et l'artillerie. L'armée française, par exemple, comporte deux types d'unités ,la cavalerie lourde, avec les cuirassiers et les dragons, et la cavalerie légère, avec les chasseurs à cheval et les hussards, sans oublier les chasseurs d'Afrique et les spahis.
Au cours des opérations de l'été 1914, la cavalerie assure surtout des missions de reconnaissance et de patrouille, le rôle des cavaliers est d'explorer, de glaner des renseignements, d'interroger pour repérer et identifier les unités adverses. C'est ainsi, par exemple, que le 31 août, un capitaine du 5ème Chasseurs rapporta qu'à Gournay-sur-Aronde, près de Compiègne, la 1ère armée allemande abandonnait la route de Paris pour aller vers le sud-est, un renseignement qui fut confirmé les jours suivants par d'autres patrouilles ainsi que par les avions du camp retranché de Paris et qui allait permettre la victoire de la Marne.
Les cavaliers dans la boue des tranchées
Après la course à la mer, à l'automne 1914, la cavalerie se retrouve dans les tranchées, comme les fantassins, et vont alors apparaître des "régiments de cavalerie à pied " (Cuirassiers à pied, etc.) qui seront considérées comme des "unités d'infanterie" à part entière. Néanmoins, lors de chaque grande offensive, des divisions de cavalerie sont regroupées en arrière du front, avec leurs chevaux, dans l'espoir de pouvoir exploiter une hypothétique future percée. On verra même, lors des offensives de Champagne de l'automne 1915, des Hussards et des Chasseurs charger sur leurs montures les deuxièmes et troisièmes lignes allemandes après que l'infanterie soit parvenue à capturer la première.
Avec la reprise de la guerre de mouvement, à partir du printemps 1918, la cavalerie, par sa mobilité, va retrouver une certaine utilité mais avec l'utilisation des chars d'assaut qui se généralise, son rôle restera limité dans les différentes opérations de la fin de la guerre.
La dernière charge de cavalerie de la Grande Guerre est à l'actif de l'armée belge, dans les environs de Maldeghem, le 19 octobre 1918, mais avant cela, en Picardie, le 30 mars, la brigade de cavalerie canadienne contribua à l'arrêt de l'offensive allemande sur Amiens en chargeant l'infanterie ennemie qu'elle délogea du bois de Moreuil.
Crédits photographiques © Wikipedia